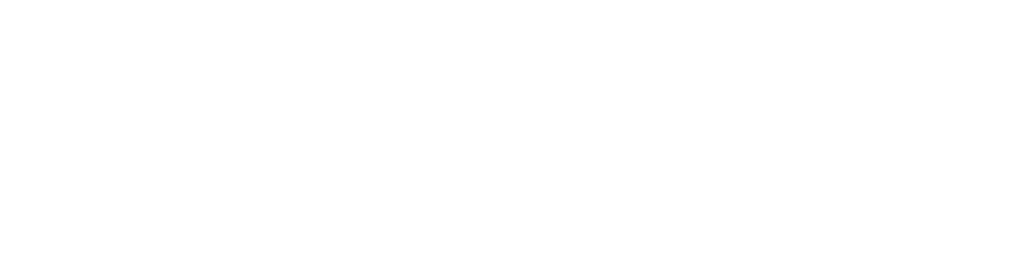Recherche interdisciplinaire
La pluri et l’interdisciplinarité figurent parmi les missions des Maisons des sciences de l’homme depuis leur création. La confrontation des disciplines et des méthodes est aujourd’hui le meilleur moyen de faire progresser la connaissance et d’agir pour la société dans un monde soumis à des défis majeurs. La MMSH soutient les collaborations entre sciences humaines et sociales mais également avec les sciences de la vie et de la santé, de la nature et de l’environnement ainsi qu’avec les sciences de la terre, du numérique et de l’ingénieur. Par le biais d’appels à projets de séminaires et de programmes interdisciplinaires, de réseaux et d’observatoires thématiques en études méditerranéennes, la MMSH veut incuber des projets novateurs préparant à des appels nationaux ou internationaux.
La journée se décline en trois axes et trois tables rondes thématiques qui visent à croiser les champs académiques, institutionnels
et des métiers de l’ingénierie de la recherche comme lieux de l’interdisciplinarité. Le focus que chaque table ronde consacre aux métiers
d’appui donne à voir les moyens investis dans les processus de conception, de mise en réseau et de mise en œuvre des programmes de recherche
à travers des actions et des productions diverses. Il s’agira également d’illustrer les difficultés comme la formulation, la concrétisation de projets et leur pérennisation.
Table ronde 1 : Construire une stratégie de l’interdisciplinarité
Table ronde 2 : Processus et mise en pratique de l’interdisciplinarité : retours d’expériences
Table ronde 3 : Des outils au service d’une culture interdisciplinaire et de la médiation des savoirs
Programme détaillé
MMSH café est conçu pour faire connaître les projets, les initiatives et les collaborations des équipes de la MMSH-amU CNRS.
Il s’agit d’un temps de présentation et d’échange régulier, plutôt informel et court, ouvert à tous les membres des unités qui ont souhaité partager leurs travaux,
projets, publications, colloques, création, collaborations, en cours, autour d’un café partagé dans la Salle de Convivialité.La programmation se base sur les inscriptions libres recueillies via le Framapad mis en place à cet effet. Les séances sont prévues tous les deuxièmes jeudis du mois.
Dates : 9 janvier, 6 février, 13 mars, 17 avril, 14 mai, 12 juin.
Horaires : 13h30-14h15
Lieu : MMSH, Salle de Convivialité, bâtiment C
Coordination : Nacira Abrous
______________________________________________
Rencontre 1 : 9 janvier 2025
Intervenant : Patrick, Donabédian, MCF HDR, émérite en histoire de l’art, en archéologie médiévale et en études arméniennes (LA3M AMU CNRS)
Titre : Projet de Glossaire en ligne, illustré, bilingue, des termes d’histoire de l’architecture arménienne
Abstract : Ce riche domaine est encore très insuffisamment étudié et la terminologie le concernant reste imprécise, lacunaire,
les acceptions sont parfois divergentes.
Patrick Donabédian mène ce projet depuis plusieurs années avec des collègues d’Arménie.
Le glossaire est actuellement en phase de finalisation.
Il est donc important de recueillir les réactions, suggestions et critiques émanant du public, spécialiste et non spécialiste.
Lien : glossaire.am
Illustrations : projection diaporama
________________________________________________________
Rencontre 2 : 6 février 2025
Intervenante : Stéphanie Delaguette, IRAA amU CNRS
Titre : Présentation de l’archive numérique « Documents de Recherche sur l’Architecture Antique
DoRAA est une archive numérique
dédiée à la valorisation des archives du laboratoire IRAA de la MMSH. Créé en 1957,
l’IRAA conserve près de 70 années de fouilles, de chantiers, d’études de monuments et de publications et supports diversifiés.
DoRAA propose un accès en ligne à ces documents
graphiques, iconographiques, photographiques et textuels. DoRAA est réalisée en collaboration avec le service d’exposition
des données de l’InIST, sous le logiciel Omeka-S.
Le fonds accueillera les fonds thématiques ou nominatifs
des monuments français et labellisés « Collection d’excellence »
en 2022 par le GIS CollEx-Persée.
Lien pour illustration https://doraa-iraa.inist.fr/s/doraa/page/home
_____________________________________________________________________
Rencontre 3: 13 mars ANNULÉE
Elodie Attia, TDMAM AMU CNRS
______________________________________________________________________
Rencontre 4 : 17 avril 2025
Intervenante : Gaëlle De La Portbarre-Viard , TDMAM amU
Titre : L’ANR E-CCLESIA – Construire l’église-monument par les textes et les images dans l’Occident latin (IVe-XIIe siècle)
Le projet E-cclesia – Construire l’église-monument par les textes et les images dans l’Occident latin (IVe-XIIe siècle) a pour objectif de déterminer le statut du bâtiment-église
dans la société tardo-antique et médiévale, au moment où il devient progressivement métonymie de l’Église-institution. Il part de l’hypothèse selon laquelle l’analyse des discours
et des représentations est nécessaire pour saisir la nature, la fonction et la valeur symbolique mais aussi patrimoniale des édifices de culte.
Il s’agit pour cela de mener une étude précise des sources textuelles et iconographiques pour mettre en évidence la transformation des lexiques verbaux et visuels
comme expression d’une pensée complexe du rôle de l’Église-institution dans la société tardo-antique et médiévale ainsi que de la valeur matérielle et spirituelle du bâtiment-église…
Liens : https://tdmam.cnrs.fr/spip.php?article941
https://ecclesia.hypotheses.org/
Illustrations : Diaporama
________________________________________________________________
Rencontre 5 :14 mai 2025
Intervenante : Sandrine Borel-Dubourg, IRAA CNRS, Alain Badie, IRAA CNRS, M. Panneau, IRAA amU CNRS et A. Papadopoulou IRAA amU CNRS
Titre : Le théâtre antique d’Orange – suivi archéologique et Projet TAIC2 « Un théâtre antique intelligent et connecté
Résumé Le théâtre d’Orange est un monument majeur de l’histoire de l’architecture inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et un grand équipement culturel contemporain. Depuis 2015, il fait l’objet d’une campagne de restauration qui se poursuivra jusqu’à fin 2025. Il s’agit pour l’Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (UAR 3155) en charge du suivi archéologique des travaux, d’une opportunité unique d’approfondir son étude architecturale et stratigraphique.
L’enjeu du projet TAIC2 (2022-2025), porté par l’IRAA et soutenu par la Fondation A*Midex d’amU, vise à développer des protocoles favorisant une démarche interdisciplinaire de la recherche, en collaboration avec les acteurs patrimoniaux, économiques et culturels impliqués dans la conservation, l’étude et la valorisation du monument. Dans cette perspective, le projet s’appuie sur les acquis éprouvés des Systèmes d’Information Géographique (SIG) en archéologie, qu’il articule avec le potentiel du HBIM (Historical Building Information Modeling). Ce processus, spécifiquement adapté à la gestion patrimoniale, est ici appliqué pour la première fois en France à un édifice antique. Il permet un travail collaboratif autour d’une maquette 3D paramétrique du monument, connectée à une base de données structurée rassemblant l’ensemble des informations relatives au bâtiment.
Située à la croisée de l’architecture, de l’archéologie et des sciences de l’ingénieur, notre démarche interroge l’adaptabilité du HBIM à l’analyse archéologique de l’architecture monumentale et son interopérabilité avec un SIG afin de pouvoir appréhender le monument à la fois à l’échelle du détail archéologique comme à celle territoriale. L’objectif est de proposer une méthodologie inscrite dans la science ouverte, reproductible et transférable à d’autres sites patrimoniaux, positionnant le HBIM comme un outil au service des sciences historiques pour structurer, croiser et valoriser un corpus de données hétérogènes relatives à un monument.
Cette communication vise à exposer la méthodologie d’acquisition des données appliquée lors des opérations de terrain, ainsi que l’état d’avancement du projet de recherche, fondé sur l’exploitation des données issues du suivi archéologique.
Illustrations : Projection diaporama
_______________________________________________________________
Rencontre 6 : 12 juin 2025
Intervenante : Florence Renucci et Isabelle Thiébau (IMAF amU)
Titre : Projet bibliothèque numérique sur les revues en situation coloniale (Afrique, Asie…)
Illustrations : visionnage sur écran de la bibliothèque en ligne, diaporama
Dispositif : Réseau thématique
Axe(s) : International -Shs de site
Labos associés : IDEAS, TELEMMe
Responsables scientifiques :
Laurence Hérault, PR AMU IDEAS
Karine LAMBERT, MCF Université de Nice et chercheuse rattachée à TELEMME
Dans l’objectif de renouveler et de développer le réseau GenderMed initié dans le cadre de la MMSH, le projet propose de fédérer, dans une perspective interdisciplinaire/pluridisciplinaire, des équipes de
recherches travaillant sur les questions de genre à la fois au sein d’AMU mais aussi dans le cadre de l’alliance CIVIS et en Afrique méditerranéenne et subsaharienne.
Cette initiative d’un réseau francophone en Études de genre s’inscrit également au sein du CIVIS Gender Studies Network (CGSN) qui organise depuis 2023 des séminaires en lignes sur le genre.
Présentation du Réseau document complet
Focus : École doctorale internationale
Le BruLau est une école doctorale internationale francophone en études de genre, créées par le Centre d’Études Genre (CEG) de l’Université de Lausanne (UNIL) et la Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l’égalité et la sexualité (STRIGES) de l’Université libre de Bruxelles (ULB). En 2025, la collaboration s’élargit à Aix-Marseille Université et l’Université de Bucarest. le BruLau se tiendra du 2 au 6 juin à Marseille . 5 jours de formation interdisciplinaire, interactive et personnalisée
Les thématiques qui y seront développées (genre et migrations, genre et alimentation, violences faites aux femmes, performances queers) rendent visibles les thématiques de recherche développées au sein d’AMU et sont déclinées en plusieurs modalités de formation : « grandes conférences » réunissant des chercheur.euses spécialistes, des « ateliers du genre » où les travaux des doctorant·es seront discutés, des « ateliers méthodologiques et professionnalisants » et enfin des « tête-à-tête » entre doctorant·es et mentor·es sur un format de speed-dating.
L’école doctorale :Le programme
La participation aux grandes conférences est ouverte au public et gratuite sur inscription obligatoire en envoyant un e-mail à cette adresse brulau2025@univ-amu.fr
Dispositif : Réseau thématique
Axe thématique : International
Labos associés : IDEAS, IREMAM
Responsables scientifiques : Malika Assam, MCF IREMAM amU et Giulia Fabbiano, MCF IDEAS amU
Le réseau thématique « Le Maghreb des anthropologues. Écritures et circulations depuis les indépendances » se propose de fédérer des chercheurs et des chercheuses internationaux·les en anthropologie, études berbères/amazighes, arabes dialectales, en dialogue avec les disciplines proches (histoire, sociologie, science politique) dans un double objectif : mener un état de lieu et une cartographie ; engager un chantier éditorial.
L’analyse des acteurs, de leurs trajectoires intellectuelles et disciplinaires, de leurs inscriptions institutionnelles et de leurs domaines de recherche permettra de questionner les champs de production, de circulation, de diffusion et de médiation du savoir anthropologique à partir du Maghreb.
Le document de présentation du Réseau MECCIR
Les RDV de l’année 2025
21 mars : Salle Duby Rencontre inaugurale du réseau : Anthropologie du Maghreb et études berbères en France Invités : Tassadit Yacine EHESS Paris et Mohand Anaris, LLacnad INALCO Paris
5 mai : Salle PAF Atelier 2 : Enjeux de la recherche et de la formation anthropologiques au Maroc
Avec
Fadma AIT MOUS, LADSIS, U. Hassan II, Casablanca ; Anouk COHEN, Centre Jacques Berque, Rabat ; Aboulkacem EL KHATIR, Centre des Études Anthropologiques et Sociologiques, Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat ;Victoire JAQUET, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, Université Paris Nanterre ; Khalid MOUNA, Laboratoire Homme, Sociétés et Espace (LAHSE), U. Moulay Ismail, Meknès
Dispositif : séjour – résidence (AAP – MMSH 2025)
Axes : science-société-art et invention
Artiste invitée : Victoire Barbot
3 laboratoires d’archéologie associés
- LAMPEA (Préhistoire)
- LA3M (Études médiévales et modernes)
- Le Centre Camille Jullian (Protohistoire-fin de l’Antiquité)
Partenaires
- Association Voyons Voir (résidences artistiques, art contemporain et territoire)
- Institut ARKAIA
- Pôle édition et service communication de la MMSH
Ce programme « séjour » ouvre l’accès aux laboratoires d’archéologie pour une résidence artistique de quatre semaines à la MMSH. L’artiste invitée, Victoire Barbot, observera les processus de travail en laboratoire – stockage, manipulation, traitement des matériaux archéologiques – pour établir un protocole de création. Son approche créative entend faire émerger des objets imaginaires et chimériques à partir de matériaux variés issus des différents champs d’études rencontrés. Parallèlement, les aspects éthiques et juridiques liés à l’utilisation ou la reproduction des matériaux archéologiques seront explorés. La documentation des étapes du processus de recherche-création permettra de restituer les questionnements émergeant de l’interaction entre les protocoles artistiques et scientifiques afin d’informer le public sur les potentiels et les limites de la création artistique à partir de matériaux archéologiques et scientifiques.
Responsables scientifiques
Abigaël Pesses : abigael.pesses[a]univ-amu.fr
Anne Mailloux : anne.mailloux[a]univ-amu.fr
Giulia Boetto : giulia.boetto[a]univ-amu.fr
Gwenaëlle Goude : gwenaelle.goude[a]univ-amu.fr
Le séminaire, coordonné par Isabel Fernandez (LPCPP-UR3278), Francesca Manzari (CIELAM – UR4235) et Sabine Luciani (TDMAM-UMR 7297),
porte sur une pratique sociale qui remonte à l’Antiquité. Grecs et Romains faisaient volontiers appel aux pouvoirs du logos pour modérer le chagrin suscité par les événements malheureux. Cet arsenal discursif est aujourd’hui discrédité par ses aspirations normatives et ses prétentions rationnelles. Cependant, l’acte de consoler demeure un impératif social,
même s’il emprunte de nouvelles voies, dont témoignent notamment la psychanalyse, l’art-thérapie ou les éthiques du care.
L’objectif est de croiser approches scientifiques et expériences thérapeutiques pour mieux saisir les enjeux d’une pratique qui est l’aboutissement d’une longue histoire.
Axe thématique: Science-société-art (cf. AAP MMSH 2025)
Labos associés : TDMAM, LCPP, CIELAM
Responsables scientifiques :
Sabine Luciani, PR, AMU TDMAM
Isabel Fernandez, MCF, LCPP AMU
Francesca Manzari, PR CIELAM
PRÉSENTATION. Le document complet
Les communications de la JE « Consoler et guérir » sont disponibles sur la chaîne Mediamed de Canal-u.
https://www.canal-u.tv/chaines/mediamed/consolation , sous-rubrique : Consoler et guérir : https://www.canal-u.tv/chaines/mediamed/consolation/consoler-guerir
Les RDV de l’année
5 février 2025 Journée d’étude Consoler et Guérir. La consolation au prisme des sciences humaines et sociales
21 mars 2025
Les religion face à la consolation
Présidence Sabine LUCIANI, Aix Marseille Univ, CNRS, TDMAM
Intervenants :
Emmanuel BAIN, Aix Marseille Univ, CNRS, TELEMMe
« Le consolamentum des hérétiques »
Francesca MANZARI, Aix Marseille Univ, CIELAM
« La consolation dans le dispositif providence-destin de la théologie chrétienne. Foucault et Agamben pour lire Pétrarque »
Téléchargez la version PDF du programme
Séance 2 – Jeudi 17 avril 2025, 9h30-12h30
Y A T-IL UNE CLINIQUE DE LA CONSOLATION ?
Présidence Isabel FERNANDEZ, Aix Marseille Univ, LPCPP
Intervenants
Fanny CHEVALIER, Aix Marseille Univ, LPCPP
« Deuil et consolation en psychanalyse »
Theo LUCCIARDI, Aix Marseille Univ, LPCPP
« L’institution de soin peut-elle consoler ? »
Séance 3 – Jeudi 22 mai 2025, 15h-18h
MIGRATION ET CONSOLATION
Présidence Michèle GALLY, Aix Marseille Univ, CIELAM
Intervenants
Alexis NUSELOVICI, Aix Marseille Univ, CIELAM
« L’exil comme souffrance, l’exil comme consolation »
Emma BARRETT FIEDLER, Institut Max-Planck
« Nostalgie et migration : de la clinique de l’exil au passage du temps »
Séance 4 – Jeudi 12 juin 2025, 15h-18h
LITTÉRATURE ET CONSOLATION
Présidence Francesca MANZARI, Aix Marseille Univ, CIELAM
Intervenantes
Imane-Hélène CHAMES-EDDINE, Sorbonne Université, Orient et Méditerranée
« L’art de chasser la tristesse dans la tradition arabe »
Nasim NEKOUIE NAEENIE, Aix Marseille Univ, CNRS, IREMAM
« La littérature de jeunesse, un soutien psychologique ? »
Séance 5 – Jeudi 10 Juillet 2025, 9h30-12h30
RÉPARER LES VIVANTS ?
Présidence Claudie MARTIN-ULRICH, IRCL, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Intervenants
Gil CHARBONNIER & Honoré CLAVREUL, Aix Marseille Univ, LDPSC
« La consolation en justice : le partage de la réparation »
Jean-Michel DURAFOUR, Aix Marseille Univ, LESA
« La consolation au cinéma : approche écopoétique »
Axe thématique (s) : SHS de site
Responsables scientifiques
Virginie Baby-Collin, Telemme amU.
Melissa Blanchard, Centre Norbert Elias amU.
Laboratoires associés :
TELEMMe (amU-Cnrs), CNE (amU-Cnrs)
Résumé du séminaire :
Le séminaire MIMED réunit des chercheur.es issu.es de disciplines variées des SHS, membres de 7 unités de recherche du site
(Centre Norbert Elias, TELEMMe, Mesopolhis, IDEAS, IREMAM, LPED, ADEF).
Il vise à discuter l’actualité de la recherche sur les migrations dans une optique pluridisciplinaire.
MIMED se propose d’être un espace de formation complémentaire pour les étudiant.es qui travaillent sur les thématiques migratoires et de renforcer le lien
entre les chercheur.es travaillant sur les enjeux migratoires sur le site Aix-Marseille.
Son objectif est aussi de donner plus de visibilité aux recherches
issues des laboratoires du site Aix-Marseille en dialoguant avec d’autres chercheur.es français.es ou étrange.es, ainsi qu’avec la société civile, associative, politique et artiste.
Les RDV de l’année Agenda complet
4 février 2025 Les Portugais en France : une immigration invisible?
Responsable(s) scientifique(s) :
Hélène Aurigny (MCF HDR, CCJ), Aude Cohen-Skalli (CR CNRS, TDMAM)
Axe thématique :
Science, société, art (AAP MMSH 2025)
Mots-clef : Monuments ; archéologie ; sculpture ; géographie ; voyageurs
Le succès de TOPIA auprès des étudiants et des collègues, qui en ont suivi assidûment les sessions, nous incite à les concevoir systématiquement en modalité hybride en 2025.
Nous continuerons à explorer la notion historique complexe[1] de « point de vue »
porté sur les vestiges matériels de l’Antiquité grecque dans une perspective diachronique.
Les sources que l’on confronte sont de deux types : d’une part le corpus des historiens et géographes (Strabon, Pausanias, etc.),
parfois dits aux origines du « tourisme » ; d’autres part les vestiges archéologiques et leurs interprétations modernes et contemporaines.
Les descriptions antiques de monuments grecs ont souvent été analysées d’un point de vue littéraire (l’ekphrasis)[2], mais guère sous l’angle du point de vue adopté par l’auteur-locuteur
et de ce que l’on appelle en grec l’énargéia, c’est-à-dire de l’effet visuel.
D’autre part, dans leur effort de restitution du « point de vue » antique,
l’archéologue et l’historien de l’art convoquent rarement les écrits des voyageurs anciens.
En croisant la perspective des philologues, historiens de l’art, archéologues et géographes, on peut donc progresser significativement
dans la compréhension de la façon que les Anciens avaient de regarder monuments et paysages urbains. Dans un esprit d’interdisciplinarité, on envisagera le point de vue porté sur le vestige sur un temps long, en prenant en considération d’autres regards « antiquaires » ‒ ceux de Cyriaque d’Ancône (xve s.) ou de Fauvel au xixe siècle.
Les discussions porteront donc jusqu’à l’époque contemporaine.
Le séminaire a une vocation d’enseignement et de formation à la recherche. Masterants et doctorants y participeront ; on réfléchira avec eux à la pertinence des restitutions graphiques et tridimensionnelles de monuments. Les séminaires s’intégreront dans les formations du parcours 1 du nouveau Master d’ARKAIA.
PRÉSENTATION document complet
Voir aussi TOPIA 2023-2024
[1] Par ex. T. Hölscher, Visual Power in Ancient Greece and Rome, Oakland, 2018.
[2] Cf. par ex. É. Prioux, P. Linant de Bellefonds, Voir les mythes. Poésie hellénistique et arts figurés, Paris, 2017.
Les RDV de l’année
lundi 10 février 2025 La description des monuments dans les chroniques
Projets interdisciplinaires retenus en 2025
I. LES OBSERVATOIRES (1)
Observatoire des inégalités scolaires en Méditerranée
Axe(s) : SHS de site / International
Labos associés : TELEMMe, MESOPOLHIS, IREMAM, MESOPOLHIS,
Responsables scientifiques :
Nora Nafaa, CR géographie, CNRS TELEMMe
Julien Garric, MCF en sociologie, IREMAM
Gwenaëlle Audren, MCF AMU, géographie, TELEMMe
Magali Nonjon, MCF, MESOPOLHIS, AMU
Ariane Richard-Bossez, MCF AMU MESOPOLHIS INSPE
Tal Dor, MCF, IREMAM AMU.
II. LES RÉSEAUX THÉMATIQUES (4)
1. Kaléidoscope 1989 Réseau interdisciplinaire international
Axe(s) : Science-société-art -Invention _ International
Labos associés : TELEMMe, MESOPOLHIS, IREMAM, MESOPOLHIS
Responsables scientifiques :
Céline Lesourd, CR, Centre Norbet Elias
Elhadj Ould Brahim, Fondation des MSH
Camille Evrard, IMAF
Nicolas Ismalia, LAP
Sidi N’Diyae, U. P.O. Nanterre
Erin Pettigrew, NYU Abu Dhabi
2. TCA Les sept faces de la brique : approche pluridisciplinaire de la céramique architecturale
Axes : Science-société-art
Labos associés : LA3M, INRAP, Département Alpes de Haute-Provence
Responsables scientifiques :
Guergana GUIONOVA, céramologue archéologue, CNRS LA3M
Nathalie MOLINA, archéologue, Inrap Marseille
Maxime DADURE, Département des Alpes de Haute-Provence.
3. Réseau francophone BRULAU en études de genre
Axe(s) : International -Shs de site
Labos associés : IDEAS, TELEMMe
Responsables scientifiques :
Laurence Hérault, PR AMU IDEAS,
Karine LAMBERT, MCF, Université de Nice/Associée TELEMMe
4. Le Maghreb des anthropologues. Écritures et circulations depuis les indépendances
Axe(s) : International
Labos associés : IDEAS, IREMAM
Responsables scientifiques :
Giulia Fabbiano, MCF AMU IDEAS
Malika Assam, MCF IREMAM AMU
III. LES SÉMINAIRES INTER LABORATOIRES (5)
1. TOPIA : Monuments, vestiges et statues
Axe(s) : Science-société-art
Labos associés : TDMAM, IRAA, CCJ
Responsables scientifiques :
Aude Cohen-Skalli, CR, Cnrs TDMAM
Hélène Aurigny MCF, Hdr, CCJ
Julien Dubouloz PR, histoire, IRAA AMU
2. IPPIMED Images du politique et politiques de l’image en Méditerranée
Axe(s) : Science-société-art – SHS de site
Labos associés : MESOPOLHIS, PRISM, IREMAM
Responsables scientifiques :
Philippe Aldrin PR, Mesopolhis
Pascal Césaro, MCF, Prism, amU
Vincent Geisser DR, IREMAM CNRS
Pierre Fournier, PR Mesopolhis
3. CONSOLATIO : Consoler et guérir. Formes et enjeux de la consolation de l’Antiquité au 21e siècle
Axe(s) : Science-société-art
Labos associés : TDMAM, LCPP, CIELAM
Responsables scientifiques :
Sabine Luciani, PR, AMU TDMAM
Isabel Fernandez, MCF, LCPP AMU
Francesca Manzari, PR CIELAM
4. Vous avez dit moderne(s) ? : Séminaire transdisciplinaire Renaissance-Lumières d’Aix-Marseille Université
Axe (s) : SHS de site
Labos associés : TELEMMe, LERMA
Responsables scientifiques :
Jérémie Foa, MCF, AMU TELEMMe
Isabelle Luciani MCF TELEMMe
Anne Page, PR, LERMA, AMU
5. MIMED : Lieux et territoires des Migrations en Méditerranée & au-delà
Axe(s) : SHS de site
Labos associés : TELEMMe, CNE Centre Norbet Elias
Responsables scientifiques :
Melissa Blanchard, CR, CNRS
Virginie Baby-Collin, PR, AMU TELEMMe,
IV. LES SÉJOURS/RÉSIDENCES (1)
Art-chéo-métrie. Mise en volume des sciences pour l’archéologie
Axe(s) : Science-société-art-invention
Labos associés : LAMPEA, CCJ, LA3M, UAR3125
Responsables scientifiques :
Abigaël Pesses, IGE, AMU-UAR
Gwenaëlle Goude, DR CNRS,
Giulia Boetto, DR CNRS CCJ
Anne Mailloux, MCF, AMU LA3M,
Date 3 février 2025
Horaires : 9 h 00 – 17 h 00
Lieu: MMSH -Salle Duby
Projection-débat autour du documentaire LAISSÉS-POUR-COMPTE, C. Félix & A. Maury
Prolongement du débat dans le séminaire éducation «Colonialitédes mondes scolaires»
Entrée libre accessible à tous publics
Responsables scientifiques :
Nora Nafaa, CR géographie, CNRS TELEMMe
Julien Garric, MCF en sociologie, IREMAM
Gwenaëlle Audren, MCF AMU, géographie, TELEMMe
Magali Nonjon, MCF, MESOPOLHIS, AMU
Ariane Richard-Bossez, MCF AMU MESOPOLHIS INSPE
Tal Dor, MCF, IREMAM AMU
Présentation
L’Observatoire des inégalités scolaires en Méditerranée associe l’IREMAM, TELEMMe, MESOPOLHIS et d’autres partenaires. Il a été sélectionné en novembre 2024 à la suite de l’AAP « MMSH 2025 ».
L’Observatoire s’inscrit dans deux axes de la politique scientifique de la MMSH : SHS de site et International. le projet reflète la volonté de développer la recherche en Éducation au sein de la MMSH-amU à propos des inégalités scolaires.
Celles-ci sont au cœur des travaux des membres du groupe : l’enjeu est de proposer des ressources à la fois méthodologiques et thématiques du point de vue des diverses disciplines engagées (histoire, géographie, sociologie).
Au prisme de cette pluridisciplinarité, il s’agira de déterminer les apports spécifiques des sciences humaines et sociales sur cet objet travaillé par ailleurs par les sciences expérimentales, ou bien encore l’économie. Il s’agira également, au-delà de la production et la diffusion de données produites par l’Observatoire, de mettre en lumière les spécificités des approches développées en sciences humaines et sociales, sur le plan du rapport au terrain, des méthodes d’enquête, de l’éthique et, notamment sur des sujets faisant débats avec d’autres champs disciplinaires comme la question de l’administration de la preuve ou de la mesure. Ce faisant l’Observatoire pourra constituer un lieu de visibilisation des approches propres aux sciences humaines et sociales sur la question des inégalités scolaires.
Organisateurs
Ariane Richard Bossez – Magali Monjon – Gwenaëlle Audren – Nora Nafaa – Tal Dor et Julien Garric
Contacts :
ariane.richard-bossez@univ-amu.fr (MESOPOLHIS)
julien.garric@univ-amu.fr (IREMAM)
nora.nafaa@univ-amu.fr (TELEMMe)
AAP de l’Institut National du Travail Social (INTS), la Mission Recherche (MiRe) de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) lance son AAP 2025
Les transformations du travail social et de l’intervention sociale.
! Date limite de candidature : vendredi 23 mai 2025
L’AAP s’adresse aux disciplines SHS et aux co-chercheurs dans le champ du travail et de l’intervention sociale. Les projets de recherche interdisciplinaire et les projets collaboratifs (recherche-action, recherche participative, etc.) sont encouragés.
Financement :
Chaque projet retenu pourra prétendre à une subvention de recherche à hauteur de 150 000 euros maximum.
Les projets de recherches devront durer 24 mois maximum.
Retrouvez ici l’intégralité du texte de l’appel et les modalités de candidature.
_____________________________________________________________________
Bourses doctorales pour les études sur le genre
sur la plateforme ARPEGE – Structure collaborative de Recherche de l’Université Toulouse Jean Jaurès
Maison de la Recherche – FRAMESPA
_________________________________________________________________________
Appel à projets inter-MSH 2025 du RMSH Réseau des MSH,
La date limite 2 juin 2025
Attention les projets doivent être validés par les MSH et visés par les directions.
Contact Chiara Chelini, Responsable de l’animation et de la coordination de communautés
Réseau national des Maisons des Sciences sociales et des Humanités – RnMSH
UAR3603 – 54 bd Raspail, 75006 Paris tél professionnel : 06 03 36 64 16 https://www.msh-reseau.fr/
_____________________________________________________________________________________
France 2030 : 6 projets lauréats du dispositif « programmes de recherche en sciences humaines et sociales »
approcher l’excellence scientifique en sciences humaines et sociales des acteurs institutionnels, socio-économiques et plus largement des citoyens
____________________________________________________________________________________
Villa Créative de l’Université d’Avignon
Dans le cadre de la programmation scientifique, artistique et pédagogique de la Villa Créative,
vous pouvez toujours proposer votre projet
Délai : 10 janvier 2025
Remplir le formulaire en ligne : https://www.inshs.cnrs.fr/fr/appel-projets-de-la-villa-creative
Note : La Villa Créative est née de la volonté d’ouvrir l’Université à la Cité, de “faire Université en dehors de l’Université”.
Dans un lieu patrimonial au cœur d’Avignon, la Villa Créative propose de croiser les publics en les invitant à se saisir d’espaces
scientifiques, pédagogiques et artistiques ouverts pour interagir, créer et produire de nouvelles connaissances.
Contact : villa-creative@univ-avignon.fr
_____________________________________________________________________
Les appels à projets et actions Amidex à venir
Les projets retenus en réponse aux appels à projets lancés par Amidex sont caractérisés par la capacité des porteurs à développer, dans leur palette thématique,
des coopérations fortes et efficaces avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la recherche, de la formation
mais aussi à accompagner la transformation de l’université en relations avec ses partenaires.
C’est dans cette optique qu’Amidex lance chaque année depuis sa création entre 5 à 10 appels
pour financer des projets ambitieux et novateurs, capables de répondre aux défis sociétaux et scientifiques.
Les appels à projets
Aix-Marseille Université – 63 La Canebière – 13001 Marseille
Direction : amidex-direction@univ-amu.fr
Le calendrier par dates de lancement
Chaque appel sera accompagné d’une communication précisant les modalités de candidature, le cadrage (public cible, dépenses éligibles, etc.), et les critères de sélection.
Les actions de Cofinancement de l’IdEx
La fondation soutient ou cofinance aussi des projets structurants qui permettent notamment de créer un effet levier
et d’augmenter les chances de sélection auprès de financeurs nationaux ou internationaux, tels que le MESR, la Commission européenne, la Région etc.
_________________________________________
La Maison Suger propose
Un mois de résidence chercheur Deadline : 16 décembre 2024
Thématique : « La vie quotidienne en France à l’époque moderne »
https://www.fmsh.fr/appels/appel-residence-la-vie-quotidienne-en-france-lepoque-moderne
Résultats de la sélection
Janvier 2025
Dates des séjours
Printemps 2025 et avant la fin 2026
Juillet 2024
________________________________________________________________________
Appel à projets ANR : science avec et pour la société – recherches participatives (2)
L’appel est en ligne à ce lien : https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-science-avec-et-pour-la-societe-recherches-participatives-2/
L’ANR lance l’appel Science avec et pour la Société Recherches Participatives 2 avec pour objectif d’accompagner la maturation de projets en émergence
Durée : de 12 à 18 mois
Financement : 100 k€ par projet.
Eligibilité : projets de recherche participative en émergence, associant des acteurs académiques et non académiques désireux de mettre en commun leurs savoirs, leurs compétences et leurs expériences pour apporter à des questions scientifiques (qu’ils auront préalablement définies ensemble) des réponses concrètes directement appropriables par la société civile.
Le portage et la coordination du projet déposé à l’appel SAPS-RA-RP2 seront assurés conjointement par deux « partenaires coordinateurs » :
- un établissement ou organisme de recherche et de diffusion des connaissances, public, français4, entrant dans le champ d’application du règlement financier (RF) de l’ANR
ET - une organisation de la société civile entrant dans le champ d’application du RF
(entreprise, ONG, association, fondation, organisation professionnelle, acteur de l’économie sociale et solidaire, opérateur culturel, autres…) .
Chaque projet doit donc identifier deux partenaires coordinateurs dans le « Document scientifique ».
Un seul de ces partenaires coordinateurs pourra être renseigné comme « coordinateur du projet » sur la plateforme de dépôt de l’ANR.
Le choix de ce coordinateur revient au consortium. Le consortium contient a minima ces deux partenaires.
____________________________________________________________________________________________________________
COLLOQUE AAP
Penser les sciences humaines et sociales dans les mondes arabes : productions, circulations et réceptions contemporaines des savoirs
Colloque coorganisé par le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (CAREP Paris)
et la Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France.
Date : 8 et 9 février 2023 au Collège de France, Amphithéâtre Maurice Halbwachs
La pôle Recherche transversale interdisciplinaire de la MMSH, dans une dynamique de soutien et de rayonnement, apporte son soutien à des équipes et projets diversifiés dans et en dehors du périmètre d’AMU et à travers lesquels La MMSH conduit à la fois une politique de mise en réseau en dehors des appels à projets et permet le développement de réseaux autour de futurs actions structurantes.
 Écoulement turbulent/ Leonard de Vinci / Source CC
Écoulement turbulent/ Leonard de Vinci / Source CC
Février 2024 Ecole thématique internationale sur le genre Corps artistique, corps médicalisé, corps ajusté en Méditerranée
Mai 2021 École Internationale de Printemps (Fès, Maroc)
Décembre 2020 CORMED I Ecole Thematique sur le genre
Projection publique
Première du documentaire Matagh. A Sacrifice for Safety (Arménie 2024, 25 min.)
You are cordially invited to the premiere of the documentary film Matagh. A Sacrifice for Safety (Armenia 2024, 25 min.).
Mardi 24 septembre, 16h30, Amphi de la MMSH, Aix-en-Provence
Tuesday, September 24th, 4.30pm
Ou sur Zoom / You can also follow the event via zoom by registering at this link
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZErdO2hrz8rGdRCqcjlqR8zgb3w_Xs73hQU
Film réalisé dans le cadre du « Programme transversal interdisciplinaire 2024 : Le sacrifice animal en milieu chrétien de l’Antiquité à nos jours »
de la MMSH et soutenu par l’Institut d’archéologie méditerranéenne (ARKAIA)
Film produced as part of the “Interdisciplinary Transversal Program 2024: Animal sacrifice in the Mediterranean” of the MMSH,
supported by the Institute for Mediterranean Archaeology (ARKAIA)
Le documentaire Matagh. A Sacrifice for Safety de Sara Nalbandyan et Yervan Rumyan est l’un des résultats du projet de recherche sur le sacrifice animal
dans les sociétés chrétiennes coordonné par Pierluigi Lanfranchi (AMU) etfinancé par la MMSH et
l’Institut ARKAIA. Le documentaire montre le rituel arménien du matagh tel qu’il est pratiqué par une famille de réfugiés du Haut-Karabakh/Artsakh.
La projection du film sera précédée d’une introduction par Patrick Donabédian (LA3M) et Yulia Antonian (Université d’État d’Erevan)
et sera suivie d’une discussion avec les auteurs du documentaire.
Pierluigi Lanfranchi animera l’événement.
Il est également possible de suivre la première via zoom en vous inscrivant à ce lien : https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZErdO2hrz8rGdRCqcjlqR8zgb3w_Xs73hQU
The documentary Matagh. A Sacrifice for Safety by Sara Nalbandyan and Yervan Rumyan is one of the results of the research project
on animal sacrifice in Christian societies coordinated by Pierluigi Lanfranchi (AMU, TDMAM) and
financed by the MMSH and the Arkaia Institute. The documentary shows the Armenian ritual of matagh as it is practiced by a family of refugees
from Nagorno-Karabakh/Artsakh. The screening will be preceded by an introduction by Patrick Donabédian (AMU, LA3M)
and Yulia Antonian (Yerevan State University) and will be followed by a discussion with the authors of the documentary. Pierluigi Lanfranchi will moderate the event.
You can also follow the event via zoom by registering at this link: https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/register/tZErdO2hrz8rGdRCqcjlqR8zgb3w_Xs73hQU
Communication, édition : Patricia Zuntow, CNRS, amU
TDMAM / Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale
Suivi pérennisation restitutions des projets interdisciplinaires : Nacira Abrous, CNRS MMSH amU
Présentation
Les conditions d’accueil des personnes migrantes en France, interrogent le respect de droits imprescriptibles
dans nos sociétés, dans un contexte politique, juridique et économique marqué par des restrictions,
de formes de conditionnalité des droits garantis, voire de non-accès ou de production d’infra-droits
et des manquements institutionnels.
Comment parler dès lors d’ « accueil » face à des situations dégradées dans des territoires d’établissement
et d’ancrage guettés par des formes de suspicion, d’hostilité, d’utilitarisme et de xénophobie,
qu’ils soient urbains, périurbains et ruraux ?
Face au manque d’effectivité de l’hospitalité, de l’accueil et de l’asile, des associations, collectifs, réseaux et solidaires tentent
d’apporter des réponses aux besoins journaliers récurrents, en mobilisant des ressources, situées ici et ailleurs. Cette journée, à l’initiative du réseau MIMED,
vise à rendre compte des différents aspects de l’(in)hospitalité, à Marseille et dans sa région et à mettre en visibilité les solidarités déployées
dans différents domaines de l’accueil et leurs modalités, dans le but de dresser des perspectives.
Plusieurs tables rondes, co-construites entre universitaires, militant·es, praticien·nes, associatif·ves,
citoyen·nes solidaires, institutionnel·les, élu·es marseillais.es et de la région, interrogeront :
1) la santé en migration ; 2) les enjeux de scolarisation, formation, travail ;
3) les questions de logement, hébergement, mise à l’abri ; 4) les formes de catégorisations et de tri des publics vulnérables.
La performance artistique Ça c’est Marseille et les projets de cartographie collaborative de l’accueil donneront à voir autrement les espaces locaux de l’accueil.
Organisation :
Réseau thématique MIMED (Migrations en Méditerranée)
(MMSH), TELEMMe, IREMAM, LEST, MiJMA (ANR)
Journée coordonnée par le collectif MIMED
Entrée sur inscription (voir ci dessous).
Affiche de l’événement/téléchargeable
Programme détaillé /PDF téléchargeable
Comité scientifique et d’organisation
Nacira Abrous, responsable Recherche transversale, CNRS, MMSH, AMU
Virginie Baby-Collin, professeure, géographe, TELEMMe, AMU
Jeremy Baudier, doctorant en anthropologie, CeRCLES, EHESS
Anne Faure, coordinatrice manifestations scientifiques, MUCEM
Vincent Geisser, chargé de recherche, sociologue, CNRS, Iremam, AMU
Léa Gouley, doctorante en sociologie, LEST, AMU
Cécile Kensy, suivi financier, CNRS MMSH
Mustapha El Miri, maître de conférences, sociologue, LEST, AMU
Polina Palash, géographe, TELEMMe, AMU
Béatrice Mesini, chargée de recherche, géographe, CNRS, TELEMMe
Marion Pontier, doctorant en sociologie, LEST, AMU
Agnès Rabion, chargée de partenariats et de valorisation, TELEMMe, AMU
Luna Russo, doctorante en géographie, TELEMMe, AMPIRIC, AMU
Marie-Aude Salomon, doctorante en géographie, TELEMMe, AMU
La MMSH UAR 3125/Pôle Recherche transversale interdisciplinaire apporte son soutien à la JE des jeunes chercheurs dans le cadre de la promotion de l’interdisciplinarité
Cette journée d’études interdisciplinaire (histoire, sociologie, anthropologie, géographie, droit, science politique) vise à explorer la production d’hégémonie par le pouvoir algérien
en relation à ses marges de 1954 à nos jours. Elle propose de penser la société algérienne contemporaine entre l’identité nationale imposée au lendemain de la guerre d’indépendance et les altérités plurielles qui placent
certains groupes en situation de subalternité : minorités ethniques, linguistiques et religieuses, émigrant·es et immigrant·es. Un premier axe questionne le processus de construction
de cette identité nationale monolithique,
tout en accordant une attention particulière aux expériences contestataires politiques et infrapolitiques, aux affirmations identitaires et aux revendications culturelles des différents
groupes de population qui se retrouvent minorés/minorisés, comme les berbérophones, les femmes et les croyant·es non musulman·es.
Le second axe interroge les migrations vers et depuis l’Algérie au prisme des législations, des discours et des représentations, des pratiques et des négociations identitaires.
En effet, l’État algérien tend, d’un côté, à intensifier le sentiment de marginalisation d’une partie de ses ressortissant·es souhaitant quitter le territoire par la criminalisation de leur projet migratoire ;
et de l’autre, à marginaliser administrativement et socialement une partie des migrant·es étranger·ères arrivant sur son territoire pour s’y installer temporairement ou durablement.
Avec le soutien de l’Institut SoMuM, des UMR MESOPOLHIS,TELEMMe, IDEAS, Migrinter et de l’École doctorale 355.Journée d’études inscrite dans le calendrier d’activités partagéesdu réseau GlobalMed – La Méditerranée et le monde, avec la collaboration de la Recherche transversale interdisciplinaire UAR3125-MMSH.
Comité d’organisation.
Léna Haziza (AMU, MESOPOLHIS, Migrinter, ICM),Margherita Rasulo (INALCO), Louna Hassaïni Moussaoui, (AMU,MESOPOLHIS, TELEMMe), Mélina Joyeux (AMU, TELEMMe),Kheloudja Amer (Nantes Université, CENS), Anna AnikparaDamon (AMU, TELEMMe) et Margot Garcin (AMU, TELEMMe).
Date et lieu
Mardi 4 juin 2024, Salle Paul Albert Février MMSH (5 rue du Chateau de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence)
Le programme complet ici


ATHAR I Maghreb ancien, anciennement programme transversal retenu à la suite de l’appel à projet transversal 2019 de la MMSH avec le programme Histoire et Archéologie du Maghreb ancien. Les laboratoires d’archéologie de la Maison, avec l’IREMAM et des chercheurs du CEREGE et de l’IMBE, ont pour principaux objectifs de :
– Donner à la MMSH les capacités de répondre, sur sollicitation des partenaires institutionnels maghrébins, à l’ensemble des problématiques de recherche posées par ce territoire méditerranéen, de l’origine de l’Homme à la période Moderne, dans leurs aspects les plus divers : occupation du sol, phénomène urbain, culture matérielle, anthropologie funéraire, architecture, environnement, etc.
– Faire se côtoyer, au sein des mêmes modules de formation assurés par des enseignants des deux rives de la Méditerranée, des étudiants maghrébins et français qui vont apprendre à se connaître, forger des liens d’estime professionnelle et d’amitié et, à terme, constituer l’ossature de la coopération archéologique du futur entre les deux rives de la Méditerranée.
– Promouvoir, aux côtés des partenaires algériens, libyens, marocains et tunisiens, toutes formes de valorisation du patrimoine du Maghreb ancien par la réalisation de publications scientifiques et de vulgarisation, le partage numérique des bases documentaires et une réflexion sur le retour vers le public de l’activité de recherche et de formation par des expositions et des aménagements de sites.
Partenariat avec SfaxForward – Cultural heritage in South Tunisia Twinning of research institutions, Commission Européenne H2020.
Coordonné par l’université de Sfax. La MMSH, en association avec la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est (MSHS) de Nice et la Maison des Sciences Humaines (MSH-ULB) de Bruxelles, participe à ce programme mis en place pour renforcer les capacités de la nouvelle Maison du Maghreb des Sciences de l’Homme (MdMSH) de l’Université de Sfax (Tunisie) autour d’un projet commun, collaboratif et participatif, centré sur l’étude et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Sud tunisien
Equipe
Solenn de Larminat IR, CCJ CNRS-AMU; Touatia Amraoui, CR CCJ CNRS-AMU et Michel Bonnifay, CCJ CNRS-AMU
2025
lancement le mois prochain d’une série de webinaires mensuels dédiés à la mesure et à la modélisation de la consommation culturelle en ligne, avec un intérêt particulier (mais non exclusif) pour l’écoute de musique. Cette série réunira des praticien·nes et des chercheur·ses de différentes communautés scientifiques et abordera en particulier (mais pas seulement) les sujets suivants :
- Les techniques de collecte et d’analyse des données sur la consommation et la production culturelle en ligne : du web scraping, des API et des journaux individuels anonymisés collectés par les plateformes, aux enquêtes, interviews, à l’ethnographie numérique et aux protocoles mixtes de collecte de données.
- La modélisation des comportements et des préférences des utilisateur·rices : exploration des différentes approches de modélisation, telles que les systèmes de recommandation, l’analyse des réseaux ou les modèles économétriques.
- L’impact des systèmes de recommandation et du design des plateformes sur la consommation de contenus : analyse de l’influence des fonctionnalités des plateformes sur les choix des utilisateur·rices et sur le paysage culturel dans son ensemble.
- La mesure des impacts économiques et sociaux des marchés culturels en ligne : effets sur les créateur·rices, les consommateur·rices et les industries culturelles.
- Les problématiques éthiques liées à la collecte et à l’analyse des données : respect de la vie privée, biais dans les données et reproductibilité des études.
Programme des webinaires pour le prochain semestre
Les webinaires ont lieu le mercredi après-midi de 15h à 16h15 (CET).
- 19 février – Harin Lee, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences
« Understanding Cultural Shifts and Diversity through Global Music Consumption »
- 12 mars – Quentin Gilliotte, Université Panthéon-Assas & CERLIS
« Analyse du discours politique des YouTubers : premiers résultats du traitement quantitatif d’un corpus textuel »
- 9 avril – Giulio Prevedello et Pietro Gravino, SONY CSL Paris
« Music Popularity Prediction and News Ecosystem Dynamics: Insights on Media Consumption »
- 14 mai – Myriam Boualami, Centre Marc Bloch & Géographie-cités
« La géographie des rappeurs à succès en France : une approche basée sur les données du streaming musical »
- 11 juin – Intervenant-e à confirmer
- 2 juillet – Intervenant-e à confirmer
Public concerné
Cette série de webinaires s’adresse aux chercheur·ses, professionnel·les de l’industrie et toute personne intéressée par l’étude scientifique de la consommation et de la participation culturelles en ligne.
Comment participer ?
Si vous souhaitez être tenu-e informé-e de l’évolution du programme nous vous invitons à vous abonner à la liste de diffusion dédiée au webinaire :
https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/mixtapes-webinar
Un lien Zoom sera envoyé aux inscrits la veille de chaque session.
Équipe et contact : Pierre Gallinari Safar, Thomas Louail et Célestin Zimmerlin
Équipe PARIS et Labcom MIXTAPES (Méthodes et données MIXTes pour l’Analyse des Pratiques d’Ecoute en Streaming)
Actions jeunes chercheurs : Journée jeunes chercheurs 23 novembre 2023