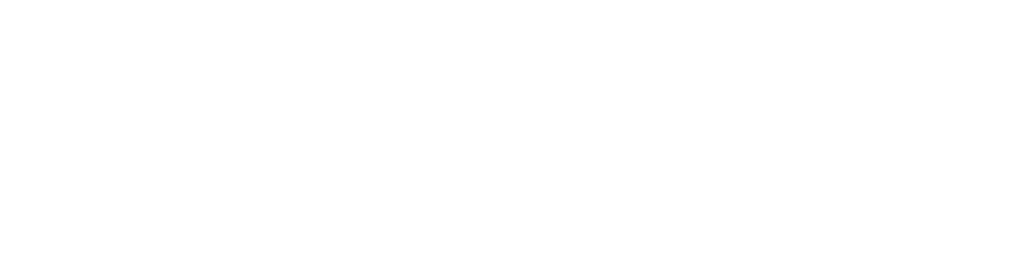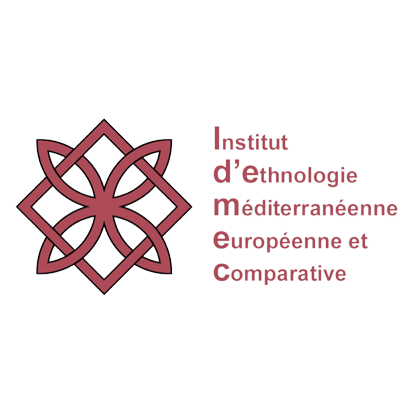
Soutenance de thèse
14h00-17h00 - Salle Georges DUBY
Soutenance de thèse d’Emma Fiedler sous la co-direction de Benoît Fliche et Laurent-Sébastien Fournier.
Rapportrice : Monica Heintz, anthropologue, Professeure des Universités, LESC (Laboratoire d’Ethnologie Sociale et Comparative), Université Paris-Nanterre
Rapportrice : Swanie Potot, sociologue, Directrice de Recherche au CNRS, URMIS (Unité de Recherche Migrations et Société), Universités Paris Cité et Nice Côte d’Azur
Examinateur : Pierre-Yves Gaudard, anthropologue et psychanalyste, Maître de Conférences, PhiléPol (Centre de Philosophie, d’Epistémologie et du Politique), Université Paris Descartes Sorbonne
Directeur de thèse : Benoît Fliche, anthropologue, Directeur de Recherche au CNRS, IDEMEC (Institut d’Ethnologie Européenne Méditerranéenne et Comparative), Université Aix-Marseille
Directeur de thèse : Laurent-Sébastien Fournier, anthropologue, Professeur des Universités, LAPCOS (Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales), Université de Nice Côte d’Azur
Contact : Carole.LE-CLOIEREC[at]univ-amu.fr
IDEMEC – Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative
ED355 – Espaces, Cultures, Sociétés
Résumé de thèse :
Ce travail s’intéresse à l’expérience intime de l’exil que font des étrangers adultes et non européens s’installant de façon régulière en France (Marseille) et en Allemagne (Leipzig, Francfort), en proposant d’explorer les conséquences psychiques et affectives de leur migration. Quels sont les effets de leur confrontation à une administration des étrangers réguliers visant à organiser, sous injonction, leur « carrière de citoyenneté » déclinée en « cours d’intégration » comprenant des formations et tests linguistiques et civiques obligatoires, pensés en continuité téléologique avec leur potentielle et très ultérieure procédure de naturalisation ? Le « travail psychique » auquel le déplacement et le changement d’environnement de vie confrontent le sujet exilé dans son intégralité comprend régulièrement – outre la perte souvent traumatique de la langue maternelle en tant que siège de pensée et d’expression – des remaniements identitaires intenses, une nostalgie sensorielle venant habiter les souvenirs, les rêves et les corps, un auto-exotisme de défense ravivé par les frustrations du présent et le rejet en bloc du pays d’arrivée, un certain dilemme d’appartenance entre deux allégeances nationales parfois contradictoires, une remise en cause des idéaux, jusqu’à une phase de renoncement ou de deuil de l’objet perdu, à laquelle la seule alternative semble être le mythe du retour en pays d’origine. L’acmé critique de cette condition subjective de l’exil se voit ici exacerbé par une administration entreprenant de brider les temporalités du travail psychique à l’œuvre en hâtant une assimilation imposée ; la résistance à cette imposition contraignante a tendance à aggraver l’expérience subjective de l’exil et à raviver la nostalgie, jusqu’à produire, bien contre-productivement, des Étrangers.